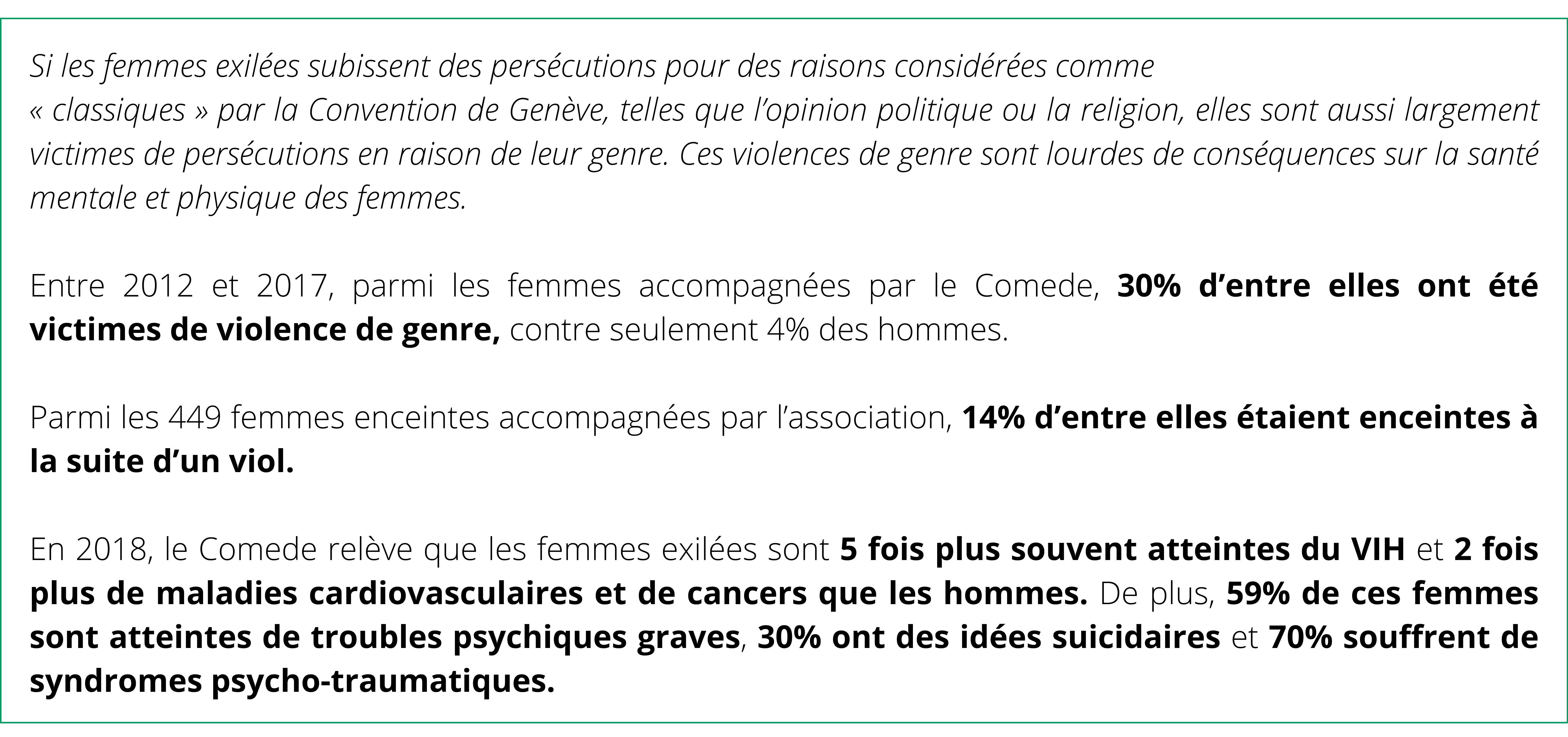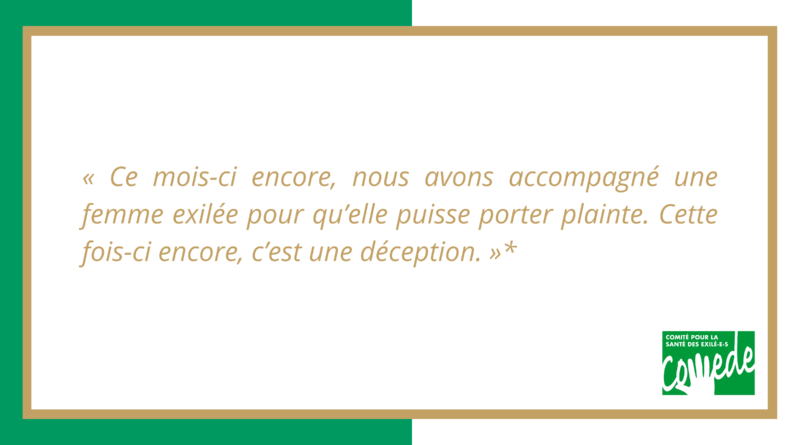Femmes exilées : victimes invisibles ?
Bénédicte Maraval, assistante sociale au Comede, association agissant pour la santé et les droits des personnes exilées
« La vérité c’est que, quoi que tu dises, au fond, quand tu es victime de viol, tu ne pars pas vraiment gagnante… » Giulia Foïs, Je suis une sur deux, 2020
Ce mois-ci encore, nous avons accompagné une femme exilée pour qu’elle puisse porter plainte. Cette fois-ci encore, c’est une déception. Pourtant, à chaque fois j’y crois, je me dis « Là, on est en plein dans l’actualité, ce n’est pas possible que cette plainte n’aboutisse pas… ».
Cela commence donc par un rendez-vous au commissariat. Des histoires de voitures volées, d’agressions au couteau, de frère en garde à vue, de procuration pour les élections et, au milieu de tout ça, nous. “Nous”, c’est à chaque fois une femme, parfois avec ses enfants. Aujourd’hui, il s’agit d’un dépôt de plainte pour violences conjugales, mais l’histoire ne s’arrête pas là. C’est une maman qui veut déposer plainte parce qu’elle craint que sa fille soit aussi victime de cet homme.
Il y a quelques jours, elle nous parlait de ses craintes, de ses soupçons d’inceste sur sa fille. Elle ne comprend pas pourquoi ces derniers temps elle dort profondément, comme si elle avait été droguée. Elle qui a toujours eu le sommeil léger et s’est toujours réveillée au moindre bruit de ses enfants. Elle a peur pour elle, pour sa fille dont le comportement a changé. Elle veut la protéger.
L’été dernier, elle a réussi à porter plainte pour violences conjugales. Au bout de quatre jours, elle a eu peur des menaces et, en même temps, elle est consciente d’être prise dans une relation complexe. Elle a retiré sa plainte. Nous lui proposons de l’accompagner au commissariat, ailleurs. Elle accepte tout de suite. L’organisation n’a pas été simple, il a fallu prendre le temps de trouver un interprète qui se déplace avec nous.
Durant le rendez-vous, je reste avec les enfants dans la salle d’attente, elle suit l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) de la Brigade de Protection des Familles. Le temps est long, la salle est petite, les avocats et plaignants se succèdent. Nous voyons défiler les agents en uniforme, en civil. Midi approche, la porte du couloir s’ouvre. C’est elle qui descend. Elle nous retrouve, l’interprète aussi, et puis rien. Pas un mot de l’officier, pas un mot sur les suites, pas un mot sur la mise à l’abri, rien. Nous partons, je suis sans voix. Sur le parking, elle me fait lire la plainte. Je découvre une succession de questions pré-écrites, suivies de réponses succinctes :
« – Avez-vous déjà déposé plainte (ou une main courante) contre votre partenaire ? Quelles ont été les suites judiciaires ?
– Oui, à trois reprises. »
S’en suivent questions ne laissant place à aucun développement :
« – Avez-vous la possibilité d’être hébergée chez un proche ou avez-vous besoin d’un hébergement d’urgence ?
– Non. »
Deux heures trente d’audition, pour six pages de “oui”, “non”, “je ne sais pas”…
J’échange avec elle :
« – Mais alors, tout ce que vous avez pu déposer dans nos bureaux au
Comede ? Toutes vos alertes, vousne leur en avez pas parlé ? »
L’interprète m’explique qu’elle en a parlé, que les policiers lui ont demandé si elle avait vu son compagnon faire du mal à sa petite fille.
« – Non. »
Alors, on lui aurait répondu que “les enfants mentent” et que, si elle ne l’avait pas vu, alors ce n’était pas un fait. Dans la plainte, il n’y a aucune allusion à cette discussion, à ses soupçons, ses inquiétudes quant au changement de comportement de sa fille. Un rendez-vous médical est prévu pour la mère aux UMJ (Unités Médico-Judiciaires), la plainte semble enregistrée, mais tout est écrit pour qu’il ne se passe rien. Ni pour elle, ni pour sa fille.
Je pose la même question que les OPJ, mais cette fois-ci en deux temps :
« – Avez-vous la possibilité d’être hébergée par un proche ?
– Non
– Avez-vous besoin d’un hébergement d’urgence ?
– Oui, j’ai peur. Je ne veux pas rentrer chez moi. »
Au fil de ces accompagnements, je constate que cette expérience en raconte d’autres, avec leurs lots de plaintes, de rendez-vous au commissariat, d’inaction… Cette situation n’a rien d’exceptionnel.
C’est celle de cette femme victime de violences conjugales qui a dû porter plainte trois fois et avoir des ITT (interruption temporaire de travail) de plusieurs jours à la suite des coups de son conjoint pour qu’enfin elle soit exfiltrée de chez elle. Elle a finalement été mise à l’abri dans une petite chambre d’hôtel avec ses trois enfants.
C’est celle de cette jeune femme victime de viol. Sa plainte a été classée sans suite : « pas assez d’éléments ». C’est celle de cette femme qui connaît le nom de son agresseur, son adresse et donne des éléments très précis dans sa plainte. Tout y est enregistré, déposé. Nous n’avions plus aucune nouvelle… jusqu’à ce que nous apprenions que la plainte avait été égarée.
C’est celle de cette femme enceinte à la suite d’un viol et qui souhaite avorter. Faible espoir : l’ADN du violeur pourrait être identifié. Mais au fur et à mesure des auditions, sa parole est mise en doute. Elle s’effondre.
Depuis 2018, au centre de santé du Comede, nous avons recueilli les témoignages de 24 femmes victimes de viol en France. Toutes celles à qui s’est arrivé ne le disent pas. Toutes celles à qui s’est arrivé ne portent pas plainte. À chaque dépôt de plainte s’ensuit une déception. À chaque dépôt de plainte s’ensuit un constat : la plainte n’est pas un aboutissement, elle n’est pas un élément d’alerte pour les pouvoirs publics. À chaque dépôt de plainte vient un doute : parce que les femmes que nous accompagnons sont étrangères, ne maîtrisent pas toujours le français, se trouvent en situation de très grande précarité, sont parfois sans papiers… leur parole est-elle moins crédible, moins importante ?